Le surréalisme est un mouvement de l’art moderne qui aura une grande influence sur le cinéma, l’art pictural et la litérature. Le mouvement artistique naît en 1929, quand l’écrivain et théoricien André Breton décide de se séparer définitivement du mouvement dada. Le surréalisme rassemble des icônes de l’art moderne, tels Salvador Dalí, René Magritte, Luis Buñuel, Max Ernst, Joan Míro et Man Ray.
Le surréalisme est l’un des mouvements les plus représentatifs de la pensée du 20e siècle. Il poursuit les inventions du cubisme. La peinture y est onirique, pleine de messages et de sens cachés.
Le mouvement artistique surréaliste s’imposa principalement entre la 1ere et la 2e Guerre mondiale.
Plusieurs courants artistiques annoncent la naissance de la peinture surréaliste. Parmi ceux-ci, on peut noter le naturalisme, le symbolisme et le cubisme.
Le surréalisme est néanmoins principalement né du mouvement Dada. Le dadaïsme, dont le nom a été créé au hasard, se voulait être une réaction contre la Première Guerre mondiale et les conventions de l’époque.
Le surréalisme naît en 1926, en réaction au risque d’une nouvelle guerre, sous le manifeste du surréalisme écrit par André Breton.
À cette époque, les théories psychanalytiques de Freud fascinent les gens et surtout les artistes. On y traite du subconscient, de l’inconscient et de l’interprétation des rêves.
Ces nouvelles théories inspirent les peintres qui voient dans ces sujets de nouvelles techniques d’explorations picturales et souhaitent tirer parti de ce monde imaginaire et onirique.
Les peintres ne désirent pas interpréter leurs rêves. Ils souhaitent les mettre en scène esthétiquement sur la toile, les représenter en puisant directement dans leur inconscient. Leurs tableaux décrivent le fonctionnement de leur imagination, ils sont une description de la mécanique de la pensée.
La Révolution surréaliste, revue crée en 1924, fut dirigée par Pierre Naville et par Benjamin Péret.
C’est en 1930 qu’ils choisirent de modifier son nom pour « Le Surréalisme au service de la révolution », démontrant clairement la tendance politique du mouvement.
Ce n’est qu’à partir de 1936 qu’eurent lieu les premières expositions internationales surréalistes.
Après ces fameuses expositions dont la plus célèbre eut lieu à la Galerie des Beaux-Arts de Paris, en 1938, l’évolution esthétique due au surréalisme marqua l’histoire.
Il existe de nombreux artistes surréalistes, tous très créatifs et novateurs.
Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Salvator Dali, le plus fantasque et excentrique peintre surréaliste, Max Ernst, qui peuple ses toiles de personnages oniriques, René Magritte, maître de la peinture en trompe-l’oeil qui allie les jeux de mots et les jeux de sens, ou encore Marc Chagall et De Chirico.
L’atmosphère onirique caractérise tous ces artistes qui allient le monde intérieur à des messages invitant à la réflexion.
L’engagement politique du mouvement engendré par André Breton fut la cause principale d’une multitude de querelles entre les artistes surréalistes.
À la fin des années 1920 : le Second Manifeste du surréalisme, publié en 1929, souligne l’arrivée de nouveaux membres ainsi que la réconciliation avec Tzara.
Entre 1925 et 1933, il y eut plusieurs oppositions auprès de Breton. Le groupe composé d’André Masson, Joan Miró, Michel Leiris et Antonin Artaud rejoignit Georges Bataille et la revue Documents puis qualifièrent le travail de Breton de « matérialisme vulgaire ».
En revanche, le groupe formé de Jacques Prévert, Marcel Duhamel et Yves Tanguy, s’éloigne radicalement du mouvement. En 1929, Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal, Roger Vailland et le peintre tchèque Joseph Sima créèrent, également en opposition à Breton, la revue le Grand Jeu.
En 1933, les surréalistes de toutes allégeances se rassemblent et participèrent à la revue Minotaure, fondée par l’éditeur Albert Skira. En 1937, André Breton en devint le rédacteur en chef.
Le surréalisme influença d’importants mouvements littéraires et artistiques dans les années 60. Les artistes du Pop art et les « nouveaux réalistes » se prétendaient d’ailleurs adeptes du mouvement. En 1969, trois ans après la mort d’André Breton, Jean Schuster signa officiellement, dans le quotidien le Monde, l’acte de décès du mouvement.
La Première Guerre mondiale dispersa les écrivains et les artistes qui étaient à Paris. Nombreux étaient impliqués dans le mouvement Dada, et estimaient que la pensée rationnelle excessive et les valeurs bourgeoises étaient à l’origine de ce terrifiant conflit dans le monde.
Les dadaïstes protestèrent avec des rencontres anti-rationnelles et anti-art, des spectacles, de l’écriture et des œuvres d’art. Après la guerre, quand ils retournèrent à Paris, les activités Dada continuèrent.
Au cours de la guerre, le chef en devenir du surréalisme André Breton, possédant une formation en médecine et en psychiatrie, servi dans un hôpital neurologique où il utilisa les méthodes psychanalytiques de Sigmund Freud sur des soldats. Il rencontra également le jeune écrivain Jacques Vache.
Breton écrivit : « Dans la littérature, j’ai eu pour inspiration Rimbaud, Jarry, Apollinaire et Lautréamont, successivement, mais c’est à Jacques Vache que je dois le plus. »
De retour à Paris, Breton se joignit aux activités des dadaïstes et inaugura la revue littéraire « Littérature » avec Louis Aragon et Philippe Soupault. Ils commencèrent à expérimenter avec l’écriture automatique en écrivant spontanément leurs pensées, sans aucune censure.
Breton et Soupault plongèrent plus profondément dans l’automatisme et rédigèrent « Les champs magnétiques », en 1919. Ils poursuivirent l’écriture automatique en plus de recruter de plus en plus d’artistes et d’écrivains dans le groupe.
Ils en vinrent alors à croire que l’écriture automatique était une meilleure tactique pour l’évolution de la société que d’attaquer les valeurs à la façon Dada.
Les travaux de Freud sur la liberté d’association, l’analyse des rêves et l’inconscient furent de la plus haute importance pour les surréalistes afin de mettre au point des méthodes pour libérer l’imagination.
Ils adoptèrent toutefois une idiosyncrasie, tout en rejetant l’idée d’une folie sous-jacente ou de l’obscurité de l’esprit. Plus tard, l’idiosyncrasique Salvador Dalí déclara : « Il n’y a qu’une seule différence entre le fou et moi : je ne suis pas fou. »
Le groupe visait à révolutionner l’expérience humaine, y compris ses aspects personnels, culturels et sociaux, en libérant les gens de ce qu’ils considéraient comme une fausse rationalité.
Breton proclamait que le véritable objectif du surréalisme était : « Vive la révolution sociale ! » Pour atteindre cet objectif, les surréalistes s’associèrent, à divers moments, au communisme et à l’anarchisme.
En 1924, ils déclarèrent leurs intentions avec la publication du premier Manifeste du surréalisme. Cette même année, ils créèrent le Bureau de la recherche surréaliste et commencèrent à publier la revue La Révolution surréaliste.

Tout au long des années 30, le surréalisme continua à devenir de plus en plus visible au grand public. Les « Expositions internationales du surréalisme », à Londres en 1936, d’un groupe surréaliste développé en Grande-Bretagne, furent, selon Breton, une grande empreinte de la période et devinrent un modèle pour les expositions internationales.
Dali et Magritte créèrent les images les plus largement reconnues du mouvement. Dali joignit le groupe en 1929 et participa à la mise en place rapide du style visuel, entre 1930 et 1935.
Le surréalisme, comme mouvement artistique visuel, avait trouvé une méthode : exposer la vérité psychologique en éliminant l’importance des objets ordinaires afin de créer une image au-delà de l’ordinaire et de susciter l’empathie du spectateur.
1931 fut une année où plusieurs peintres surréalistes produisirent des oeuvres marquantes dans l’évolution stylistique.
« La voix des airs », de Magritte, est un exemple de ce processus où les trois boules représentent de grandes cloches accrochées au-dessus d’un paysage.
Un autre paysage surréaliste de cette même année est « Le palais promontoire » d’Yves Tanguy, avec ses formes fondues et liquides. Les formes liquides devinrent la marque de commerce de Dali, en particulier dans son œuvre « La persistance de la mémoire » qui comprend l’image de montres qui s’affaissent comme si elles fusionnaient.
De 1936 à 1938, Wolfgang Paalen, Gordon Onslow Ford et Roberto Matta rejoignirent le groupe. Paalen, avec sa technique de « Fumage », et Onslow Ford, avec son « Coulage » contribuèrent à créer des nouvelles techniques picturales automatiques.
Longtemps après les tensions personnelles, politiques et professionnelles qui fragmentèrent le groupe surréaliste, Magritte et Dali continuèrent à définir un programme visuel dans le domaine des arts.
Ce programme était au-delà de la peinture, englobant aussi la photographie, comme on peut le voir à partir d’un autoportrait de Man Ray dont l’assemblage influença la boîte à collage de Robert Rauschenberg.
Au cours des années 30, Peggy Guggenheim, une importante collectionneuse d’art américaine mariée à Max Ernst, commença à promouvoir le travail des autres surréalistes tels que Tanguy et l’artiste britannique John Tunnard.
Les surréalistes veulent créer une exposition qui, en soi, soit un acte de création et ils demandent à Marcel Duchamp de le faire.
À l’entrée de l’exposition, il place le taxi de Salvador Dali pour saluer les clients en tenue de soirée. Cette pièce est en fait un taxi qui produit une bruine constante, de l’intérieur de la fenêtre, une tête de requin sur le siège conducteur et un mannequin blond rampant avec des escargots à l’arrière. Une rue surréaliste remplit l’un des côtés du hall d’accueil avec des mannequins habillés par divers surréalistes.
Duchamp conçoit le hall principal pour ressembler à une grotte souterraine avec 1200 sacs de charbon suspendus au plafond. Une seule ampoule fournissant l’éclairage, une lampe de poche est donnée à chaque visiteur pour contempler les oeuvres à l’intérieur. Le tapis est rempli de feuilles mortes, de fougères et d’herbes, et l’arôme de torréfaction du café remplit l’air.
À la satisfaction des surréalistes, l’exposition scandalise les spectateurs.

La Seconde Guerre mondiale créa le chaos, non seulement pour l’ensemble de la population européenne, mais aussi pour les artistes et les écrivains qui s’opposaient au fascisme et au nazisme.
De nombreux artistes fuirent vers l’Amérique du Nord, à la recherche d’une sécurité aux États-Unis. La communauté artistique de la ville de New York était déjà plongée dans le surréalisme et plusieurs artistes comme Arshile Gorky, Jackson Pollock, Robert Motherwell et Roberto Matta, établirent une étroite collaboration avec les artistes surréalistes eux-mêmes.
Leurs idées concernant l’inconscient et le rêve furent rapidement adoptées.
Après la Seconde Guerre mondiale, le goût de l’avant-garde américain bascula vers l’expressionnisme abstrait avec l’appui de personnes influentes telles que Peggy Guggenheim, Leo Steinberg et Clement Greenberg.
Toutefois, il ne faut pas oublier que l’expressionnisme abstrait fut créé directement des réunions d’artistes surréalistes américains auto-exilés pendant la Seconde Guerre mondiale. Arshile Gorky et Wolfgang Paalen influencèrent particulièrement le développement de cette forme d’art américain qui, comme le surréalisme, célébrait l’acte créatif instantané.
Les premières oeuvres de plusieurs artistes expressionnistes tels que Rauschenberg révélèrent un lien étroit entre les aspects superficiels de ces deux mouvements et l’émergence d’aspects dadaïstes.
La Seconde Guerre mondiale éclipsa pour un certain temps presque toute la production artistique.
En 1941, Breton se rendit aux États-Unis, où il co-fonda l’éphémère revue VVV avec Max Ernst, Marcel Duchamp et David Hare.
Toutefois, ce fut le poète américain, Charles Henri Ford et son magazine View (Voir) qui offra un véritable canal pour la promotion du surréalisme aux États-Unis. L’édition spéciale sur Duchamp fut cruciale pour la compréhension du surréalisme par le public américain. Cela souligna les connexions avec les méthodes surréalistes, offrant diverses interprétations de son oeuvre ainsi que la vision de Breton que Duchamp eut été le pont entre le début des mouvements modernes tels que le futurisme et le cubisme, et le surréalisme.
Wolfgang Paalen quitta le groupe en 1942 pour des raisons de divergences philosophiques et politiques avec Breton pour fonder le journal Dyn.
Bien que la guerre eut été perturbatrice pour le surréalisme, les travaux continuèrent. De nombreux artistes surréalistes continuèrent à explorer le vocabulaire, y compris René Magritte. De nombreux membres du mouvement surréaliste continuèrent à correspondre et à se rencontrer.
Alors que Dalí fut excommunié du groupe par André Breton, il n’abandonna pas les thématiques surréalistes dans ses peintures, y compris les références à son oeuvre « La persistance du temps ». Sa période classique ne fut pas une rupture forte avec le passé, si bien que certains, comme Thirion, dirent de son travail qu’il y avait des oeuvres qui, après cette période, continuèrent à avoir une certaine pertinence pour le mouvement.
Au cours des années 1940, l’influence du surréalisme fut ressentie autant en Angleterre qu’en Amérique. Mark Rothko avait un intérêt dans les formes biomorphiques.En Angleterre, Henry Moore, Lucian Freud, Francis Bacon et Paul Nash utilisèrent ou expérimentèrent des techniques de surréalisme.
Conroy Maddox, l’un des premiers Britanniques dont le travail surréaliste date de 1935, demeura au sein du mouvement et organisa une exposition surréaliste, en 1978, en réponse à une précédente exposition qui lui déplut, car elle ne représentait pas correctement le surréalisme.
L’exposition de Maddox, intitulée Surrealism Unlimited (Surréalisme illimité), eut lieu à Paris et attira l’attention de la communauté internationale. Sa dernière exposition solo eut lieu en 2002, et il mourut trois ans plus tard.
Magritte continua de produire des oeuvres plus réalistes avec des objets réels, tout en maintenant l’élément de juxtaposition, comme dans les oeuvres Les Valeurs Personnelles et l’Empire de la Lumière.
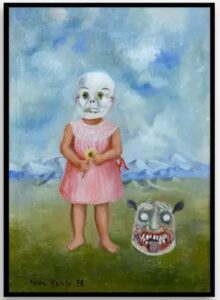
Le surréalisme se dissout peu à peu, en raison des dissensions grandissantes des têtes fortes du mouvement.
Il n’y a pas de consensus clair sur la fin, ou s’il y eut une fin au mouvement surréaliste. Certains historiens de l’art disent que c’est la Seconde Guerre mondiale qui rompît le mouvement.
Toutefois, l’historien de l’art Sarane Alexandrian croit que c’est la mort d’André BRETON, en 1966 qui marqua la fin du surréalisme comme mouvement organisé. Il y eut également des tentatives pour associer la mort de Salvador Dalí à la fin du mouvement, en 1989.
Dans les années 1960, un groupe d’artistes et d’écrivains fut étroitement associé au surréalisme. Pendant que Guy Debord critiquait et se distanciait lui-même du surréalisme, d’autres, comme Asger Jorn, utilisaient des techniques et des méthodes surréalistes. Certains événements, en 1968, en France, reprenaient un certain nombre d’idées surréalistes et les slogans peints sur les murs de la Sorbonne par des étudiants furent reliés au surréalisme.
En Europe et dans le monde entier, depuis les années 1960, des artistes combinent le surréalisme à ce que l’on croit être une technique classique du 16e siècle pour créer « Mischtechnik », une sorte de mélange redécouvert par Ernst Fuchs et qui est maintenant pratiqué et enseigné par de nombreux disciples, dont Robert Venosa et Chris Mars. L’ancien conservateur du San Francisco Museum of Modern Art, Michael Bell, nomma ce style “surréalisme vériste”, représentant un monde analogue au monde des rêves décrit avec une clarté méticuleuse et très détaillée.
Au cours des années 1980, derrière le rideau de fer, le surréalisme fit un nouveau bond en politique avec un mouvement artistique d’opposition connu sous le nom de Orange alternative.
Orange alternative fut créé en 1981 par Waldemar Fydrych, un diplômé de l’histoire de l’art de l’Université de Wroclaw.
Ils utilisèrent des symboles et des terminologies surréalistes dans des événements de grande envergure organisés dans certaines villes polonaises au cours du régime Jaruzelski. Ils peignèrent notamment des graffitis présentant des slogans anti-régime. Major fut l’auteur du Manifeste socialiste du surréalisme. Dans ce manifeste, il déclara que le système du parti socialiste (communiste) était devenu tellement surréaliste qu’il était devenu, lui-même, une expression artistique.
Le Guggenheim Museum à New York tenu, en 1999, l’exposition Two Private Eyes et, en 2001, le Tate Modern réalisa une exposition surréaliste qui attira plus de 170 000 visiteurs. En 2002, le Met de New York organisa un spectacle et le Centre Georges Pompidou de Paris tenu aussi une exposition surréaliste.
Cependant, le mouvement artistique reste sans contredit l’un des plus importants du 20e siècle, et l’un de ceux qui a fait connaître au monde les artistes les plus célèbres.
La Première Guerre mondiale engendre une aventure politique où les artistes affirment leur antinationalisme haut et fort. À la recherche d’une façon de contester contre la guerre qui détruit tout, ils se retournent contre la société et se lancent dans la provocation extrême.
Un mouvement dit « politique » que l’on surnomme Dada, avec à sa tête le poète Tristan Tzara (Sami Rosenstock) (1896-1963), rassemble des têtes pour recréer le monde.
À Zurich, en 1916, ils ouvrent un dictionnaire, trouvent au hasard le mot Dada, et en baptisent le groupe.
Dada ne veut pas créer, mais détruire l’ordre établi, en commençant par l’art, en rejetant l’idée de chef-d’œuvre. Il fait descendre l’artiste de son piédestal et revendique un art à l’image de la vie. Il veut démolir le monde bourgeois avec ses propres armes pour construire un monde nouveau sur ses ruines.
Dans les années 20, le dadaïsme se désagrège et se divise en deux clans : les disciples de Tzara, et ceux de Breton. Breton veut instaurer le règne de l’esprit nouveau en explorant avec méthode le domaine du rêve.